Avez-vous déjà eu envie de voyager au Vietnam sans prendre l’avion, simplement en ouvrant un livre ? La littérature a ce pouvoir magique de nous transporter à l’autre bout du monde, au cœur d’une ruelle animée de Hanoï ou sur les rives tranquilles du Mékong, tout en restant confortablement installé chez soi. Je vous propose aujourd’hui un voyage littéraire au Vietnam, à travers sept romans captivants qui plongent le lecteur dans l’ambiance, l’histoire et le quotidien de ce pays fascinant.
L’Amant – Marguerite Duras

On commence notre périple littéraire par un grand classique français se déroulant en Indochine des années 1930. L’Amant de Marguerite Duras est un roman court mais d’une intensité rare, à la fois autobiographique et poétique. Duras y raconte son adolescence à Saigon (aujourd’hui Hô Chi Minh-Ville), lorsqu’à quinze ans elle s’éprend d’un riche homme d’affaires chinois bien plus âgé qu’elle. Le livre ne suit pas un récit linéaire classique : il est construit comme une suite de souvenirs entremêlés, reflétant la mémoire de la narratrice. On y traverse le Mékong sur un bac rouillé aux côtés de la jeune fille en robe de soie, on parcourt les rues poussiéreuses de Cholon (le quartier chinois) où flotte l’odeur du jasmin et des fruits tropicaux. La moiteur de la jungle, le fracas des pluies de mousson, la société coloniale française avec ses codes et ses injustices : tout est dépeint d’une plume sensuelle et évocatrice.
Pourquoi ce roman est-il une étape incontournable pour un voyage littéraire au Vietnam ? Parce que L’Amant nous plonge dans l’atmosphère envoûtante de l’Indochine coloniale, un monde disparu dont subsistent les parfums et les couleurs sous la plume de Duras. À travers l’histoire d’amour scandaleuse entre la jeune fille et son amant, on découvre les tensions sociales de l’époque, le choc des cultures entre colons français, bourgeoisie chinoise et peuple vietnamien. L’immersion est telle qu’on ressent presque la chaleur écrasante de Saigon et la lumière dorée du crépuscule sur le fleuve. Sur un plan plus personnel, ce roman m’a profondément touché par sa poésie mélancolique. La narratrice raconte son histoire avec la distance du temps qui passe, comme si elle feuilletait un vieil album photo aux images un peu fanées. Certaines scènes me restent en tête des années après, notamment celle où, dans un bus cahotant sur la route de Sa Dec, l’héroïne croise le regard de l’homme qui va bouleverser sa vie. En refermant L’Amant, j’avais l’impression d’avoir moi aussi arpenté le Saigon d’antan, le cœur serré par la beauté fugace des souvenirs.
Un Américain bien tranquille – Graham Greene

Changement d’époque et de point de vue avec Un Américain bien tranquille, roman de Graham Greene publié en 1955, en plein cœur de la première guerre d’Indochine. L’histoire se déroule au début des années 1950 dans un Saigon en guerre, où l’on croise soldats français, résistants Viêt Minh et conseillers américains. Thomas Fowler, un journaliste britannique cynique et expérimenté, couvre le conflit pour son journal et savoure l’opium le soir venu pour oublier le chaos ambiant. Son quotidien bascule lorsqu’il fait la connaissance d’Alden Pyle, un jeune Américain idéaliste fraîchement débarqué, officiellement en mission humanitaire. Pyle est l’archétype de “l’innocent” plein de bonnes intentions, persuadé que son modèle démocratique peut sauver le Vietnam du colonialisme français puis du communisme. Entre Fowler, l’Européen désabusé, et Pyle, l’Américain naïvement sûr de lui, va se jouer non seulement un triangle amoureux (ils aiment tous deux Phuong, une jeune Vietnamienne), mais aussi un choc de cultures et de visions politiques. En toile de fond, des explosions secouent la ville de Saigon, des rumeurs de massacres circulent – la guerre approche d’un tournant décisif.
Pour qui veut voyager à travers l’histoire vietnamienne, ce roman est passionnant car il donne à voir le Vietnam des années 50, juste avant la chute de Dien Bien Phu et le retrait français. Greene, qui fut lui-même correspondant en Indochine, décrit avec réalisme la moiteur des nuits de Saigon, les rues de la ville où l’on sirote un café en terrasse pendant que grondent les combats en périphérie. On y ressent l’ambiance particulière de cette période : les officiers français fatigués par une guerre sans issue, l’arrivée discrète mais déterminée des Américains en coulisses, et surtout la vie quotidienne des Vietnamiens pris entre deux feux. En lisant Un Américain bien tranquille, j’ai eu le sentiment d’être attablé au mythique café Givral sur la rue Catinat, aux côtés de Fowler, à regarder défiler un pan de l’histoire du Vietnam sous mes yeux. Le roman m’a marqué par son mélange de suspense, de romance et de réflexion politique. Et quelle ironie tragique dans ce titre : l’“Américain tranquille” ne l’est peut-être pas tant que ça… Greene nous offre un regard lucide (voire prophétique) sur l’engrenage qui mènera à la guerre du Vietnam quelques années plus tard. C’est un livre qui m’a à la fois diverti et fait réfléchir, me laissant avec des images vivaces de Saigon sous tension et une nouvelle compréhension de cette époque charnière.
Le Sympathisant – Viet Thanh Nguyen

Place maintenant à un roman plus contemporain, publié en 2015, qui a connu un succès retentissant jusqu’à remporter le prix Pulitzer : Le Sympathisant de Viet Thanh Nguyen. L’auteur, vietnamien-américain, nous entraîne cette fois à la fin de la guerre du Vietnam, en 1975, puis dans l’exil aux États-Unis. Le narrateur, dont on ne connaîtra pas le nom, est un agent double : capitaine dans l’armée sud-vietnamienne et bras droit d’un général, il est en secret un espion communiste acquis à la cause du Nord. Lorsque Saigon tombe en avril 1975 dans le chaos, il s’enfuit avec son général vers la Californie, tout en continuant clandestinement à informer Hanoï. Commence alors une nouvelle vie parmi la communauté des réfugiés vietnamiens à Los Angeles, ces anciens militaires, intellectuels ou fonctionnaires déracinés qui tentent de reconstruire une « petite Saigon » en Amérique tout en rêvant parfois de reconquérir leur pays perdu. Le roman, écrit à la première personne, prend la forme d’une confession que le narrateur adresse à un mystérieux commandant. Il retrace les événements depuis la chute de Saigon : l’arrivée éprouvante dans un camp de réfugiés, l’adaptation à la vie occidentale avec ses chocs culturels (il doit apprendre à vivre en exil, entre restaurants fast-food et nostalgie du phở de rue), mais aussi ses missions d’agent infiltré parmi les exilés. Avec un humour noir décapant, Nguyen égratigne au passage Hollywood – une partie du roman narre comment notre héros sert de conseiller sur le tournage d’un film sur la guerre du Vietnam, exaspéré par la façon dont les Américains réécrivent l’histoire et réduisent les Vietnamiens à de simples figurants.
Ce qui rend Le Sympathisant passionnant dans une optique de voyage littéraire, c’est qu’il offre un double regard sur le Vietnam. D’un côté, à travers les souvenirs et les tourments du narrateur, on découvre la face vietnamienne de la guerre – les dilemmes d’un homme tiraillé entre deux idéologies, le sort des Sud-Vietnamiens contraints de fuir, la douleur de l’exil. De l’autre, on plonge dans la vie de la diaspora vietnamienne en Californie à la fin des années 1970 : les marchés où l’on tente de retrouver les saveurs du pays, les tensions entre réfugiés (certains complotent pour reprendre la lutte armée contre le régime communiste), et ce mal du pays omniprésent chez ceux qui ont tout laissé derrière eux. En lisant ce roman, j’ai voyagé non seulement au Vietnam, mais aussi dans le Vietnam intérieur de ses personnages – celui qu’ils portent en eux où qu’ils aillent. Le Sympathisant m’a tour à tour fait rire et serré le cœur. Le ton parfois sarcastique du narrateur rend la lecture très vivante, presque complice, puis soudain une scène poignante vient rappeler la tragédie vécue par tout un peuple. Je me souviens d’un passage où il décrit son retour clandestin dans une Saigon méconnaissable, rebaptisée Hô Chi Minh-Ville, et le choc que cela représente. Ce mélange d’espionnage, de satire et de drame humain m’a totalement happé. À la dernière page, j’avais l’impression d’avoir traversé l’histoire tourmentée du Vietnam moderne aux côtés d’un ami proche, tant le narrateur, avec ses contradictions, m’était devenu familier. Un livre riche en enseignements, qui donne voix à une perspective vietnamienne trop rarement entendue.
Le Chagrin de la guerre – Bảo Ninh

Revenons au Vietnam même, en plein cœur de la jungle et des rizières embrumées, avec un roman vietnamien bouleversant : Le Chagrin de la guerre de Bảo Ninh. Publié en 1991, ce livre a quelque chose de spécial : il nous fait vivre la guerre du Vietnam du point de vue d’un soldat nord-vietnamien, avec une sincérité et une intensité rarement atteintes. L’auteur, Bảo Ninh, a lui-même combattu dans les rangs du Nord pendant dix ans, et son héros Kien lui ressemble sans doute beaucoup. Kien a survécu à la guerre, mais il en porte les cicatrices visibles et invisibles. Devenu membre d’une équipe chargée de récupérer les restes des soldats tombés au combat, il parcourt les forêts où résonnent encore les échos des batailles passées. Le roman est construit par touches successives, suivant le flot désordonné de la mémoire de Kien. On passe sans cesse du présent – les années 1980, un Vietnam réunifié mais ravagé intérieurement par ses pertes – au passé : les combats dans la jungle, les marches harassantes sur la piste Hô Chi Minh, les feux de camp dans la moiteur de la nuit, et aussi les moments de grâce ou d’horreur qui ont jalonné sa jeunesse en guerre. Aucune chronologie linéaire, mais des souvenirs qui affluent, se heurtent, se répètent, à l’image de l’esprit tourmenté du protagoniste. On y trouve des scènes d’une beauté poignante, comme cette accalmie où de jeunes soldats écoutent la pluie tomber sur la canopée en fredonnant une chanson populaire, et d’autres d’une violence crue, où la jungle se transforme en enfer vert peuplé de spectres (l’expression « la forêt des cris » revient, comme si les âmes des morts hantaient encore les lieux).
Le Chagrin de la guerre est un roman essentiel pour comprendre l’âme du Vietnam d’après-guerre. À travers Kien, on découvre l’envers du décor triomphaliste souvent affiché par le régime vainqueur. Ici, pas de héros radieux ou de grande victoire célébrée : juste un homme brisé qui tente de recoller les morceaux de sa vie et de son histoire d’amour avec Phuong, son amour de jeunesse qu’il a perdu de vue pendant le conflit. Le livre nous fait ressentir le coût humain inimaginable de cette guerre longue de vingt ans qui a déchiré le pays. En tant que lecteur, j’ai été happé par la prose poétique et brute à la fois de Bảo Ninh. On se retrouve aux côtés de Kien, à errer dans un Hanoi crépusculaire des années 1980, où les vitrines s’illuminent de néons rouges tandis que lui noie son chagrin dans l’alcool de riz. Puis, sans prévenir, on est projeté vingt ans en arrière, dans la moiteur suffocante d’un champ de bataille après un assaut meurtrier. J’avoue avoir eu la gorge serrée plus d’une fois en lisant ces pages, tant elles débordent d’une émotion à fleur de peau. Ce roman m’a appris énormément de choses sur le Vietnam et les Vietnamiens : par exemple, je ne mesurais pas à quel point le Nord aussi a souffert intérieurement, perdant une génération entière de jeunes hommes dans les combats. Il m’a rappelé que derrière les mots “guerre du Vietnam” se cachent des millions de destins brisés, des parents attendant un fils qui ne rentrera jamais, des amoureux séparés à jamais. C’est un livre dur, mais d’une beauté âpre, qui m’a fait aimer encore plus ce pays pour la résilience incroyable de son peuple.
Les Paradis aveugles – Dương Thu Hương

Après la guerre vient le temps de la reconstruction… et des désillusions. Les Paradis aveugles de la romancière dissidente Dương Thu Hương nous emmène dans le Vietnam des années 1980, une décennie souvent méconnue des lecteurs occidentaux. C’est le premier roman vietnamien que j’ai lu dans ma vie, et il m’a littéralement transporté dans le quotidien d’une jeune Vietnamienne de l’après-guerre. L’héroïne, Hang, est une vingtenaire originaire du Nord, que l’on découvre au début du récit en Union soviétique où elle travaille dans une usine textile pour gagner de l’argent – car oui, dans les années 80, le Vietnam envoie de jeunes ouvriers dans les pays du bloc soviétique, un détail historique que j’ignorais avant de lire ce livre. Bloquée dans un dortoir glacial de banlieue moscovite par un hiver rude, Hang se remémore son enfance et son adolescence au Vietnam. Ses souvenirs forment le cœur du roman. On plonge alors dans un village près de Hanoï, avec ses jardins de patates douces, ses étangs de lotus et ses traditions séculaires. Mais ce n’est pas une enfance insouciante : Hang est née après la guerre, dans un pays exsangue, et sa famille porte les stigmates des conflits idéologiques. Son oncle, un fervent cadre du Parti communiste, a brisé la vie de sa propre sœur (la mère de Hang) lors des campagnes de réforme agraire violentes des années 1950. La mère de Hang, elle, s’est sacrifiée pour élever seule sa fille, enchaînant les petits métiers et vendant des boulettes de riz gluant dans les rues pour survivre. Et puis il y a l’autre figure marquante de sa jeunesse : Tante Tam, une parente restée au village, déposédée autrefois par la Révolution mais redevenue prospère, et qui voue à Hang un amour farouche mêlé de désir de revanche sociale. Tout ce petit monde évolue dans un Vietnam qui tente de trouver sa voie entre idéologie et tradition, où les « paradis » promis par le communisme se révèlent souvent aveugles, c’est-à-dire illusoires.
Ce roman est un véritable voyage sensoriel et culturel. En le lisant, j’avais l’impression de partager le quotidien de Hang : les trajets en train bondé vers Hanoï, les repas frugaux de nouilles et de légumes, les fêtes du Têt (Nouvel An vietnamien) où l’on prépare des gâteaux de riz gluant en forme de carré appelés bánh chưng. Dương Thu Hương excelle à peindre les scènes de la vie courante avec une précision presque cinématographique. Une des scènes qui m’a le plus marqué est celle d’un banquet somptueux préparé par Tante Tam pour honorer les ancêtres : je revois encore, grâce aux mots de l’auteure, la table croulant sous les mets traditionnels, les bougies éclairant timidement les visages, et Hang, partagée entre l’émerveillement et le malaise face à cette démonstration d’opulence et d’amour possessif. Les Paradis aveugles est aussi intéressant pour le regard critique qu’il porte sur la société vietnamienne post-réunification. L’auteure, qui a connu la censure et l’exil pour ses prises de position, y dénonce subtilement la corruption des cadres, l’hypocrisie et la trahison des idéaux révolutionnaires. Mais elle le fait à travers une histoire personnelle et émouvante, ce qui rend le propos d’autant plus vivant. J’ai appris beaucoup en lisant ce livre : par exemple, les ravages qu’a causés la réforme agraire au Nord Vietnam (sujet rarement évoqué dans la littérature officielle) ou encore la réalité des « boat people intérieurs » – ces jeunes comme Hang envoyés loin de chez eux pour travailler, perdus entre deux patries. Surtout, je me suis attaché à Hang et à sa famille, et j’ai eu le cœur serré de les quitter en refermant le roman, tant j’avais l’impression d’avoir vécu avec eux pendant un bout de temps. C’est un roman qui enrichit vraiment notre compréhension du Vietnam, par petites touches délicates, sans jamais tomber dans l’encyclopédisme, toujours à hauteur d’être humain.
Ru – Kim Thúy
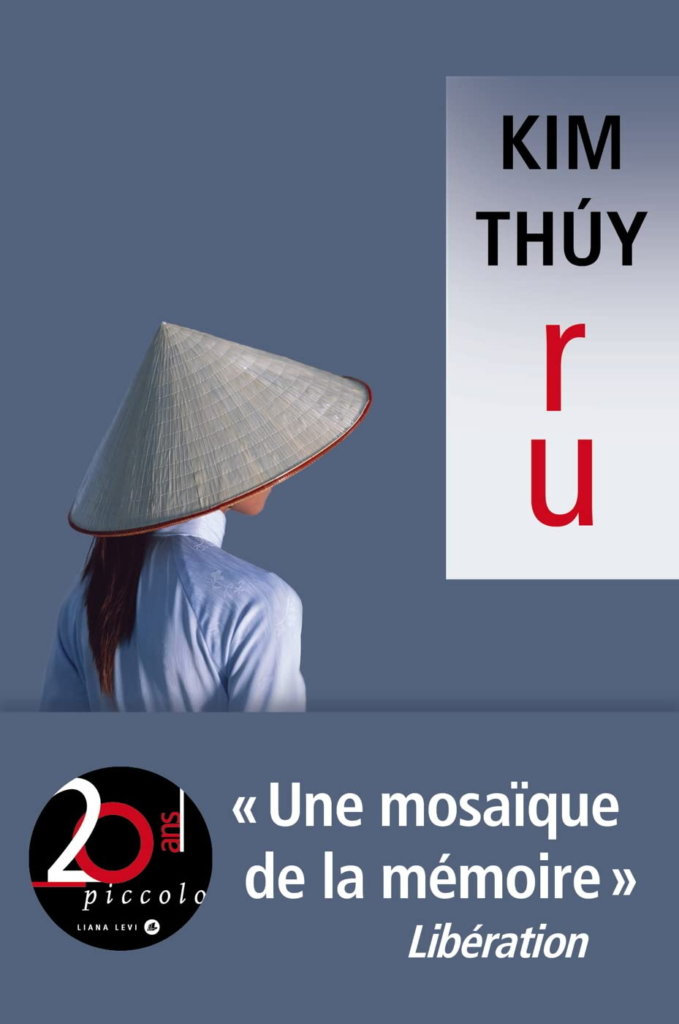
Pour cette sixième étape, prenons une autre perspective, celle de la diaspora vietnamienne au Canada, avec Ru de Kim Thúy. Ce court roman, publié en 2009, est écrit en français par une auteure originaire du Vietnam qui a émigré au Québec dans son enfance. Ru est un livre atypique, composé de brefs chapitres comme autant de souvenirs éclatés, qui ensemble forment le récit d’une vie – la vie de Nguyen An Tinh, double fictif de l’auteure. Le mot “ru” en français désigne un petit ruisseau, et en vietnamien il signifie “berceuse” ou “bercer”. Et c’est exactement l’impression que donne ce texte : un flot de mémoire qui berce le lecteur, une chanson douce-amère sur l’exil et l’enfance perdue. Le roman débute dans le luxe d’un grand bungalow de Saigon où la narratrice est née pendant l’offensive du Têt (vers 1968). Enfant, elle coule des jours heureux dans une famille aisée de la ville, malgré la guerre qui fait rage au loin. Puis vient l’heure de la chute de Saigon en 1975 : sa famille, liée à l’ancien régime du Sud, doit tout abandonner et fuir. On suit alors leur périple parmi les boat people, ces centaines de milliers de Vietnamiens qui ont pris la mer à la fin des années 1970 pour échapper au nouveau pouvoir communiste. Le récit, tout en fragments, nous fait ressentir par flashs la peur sur le bateau ballotté par les vagues, la faim et la soif, puis l’arrivée miraculeuse dans un camp de réfugiés en Malaisie. Finalement, c’est le Canada qui accueille la narratrice, alors enfant, avec sa famille. Commence alors une nouvelle vie dans le froid de l’hiver québécois, une vie d’adaptation, de mélange entre deux cultures, d’apprentissage d’une nouvelle langue, sans jamais oublier le Vietnam.
Lire Ru, c’est un peu comme feuilleter l’album-photo d’une amie qui vous raconterait sa saga familiale avec simplicité et émotion. Il n’y a pas vraiment d’intrigue linéaire, mais cela ne m’a pas empêché d’être profondément ému par ce témoignage romancé. Kim Thúy a une écriture très épurée, délicate, où chaque mot compte. En quelques phrases, elle parvient à faire revivre une odeur, une couleur, une douleur du passé. Ce roman m’a particulièrement touché par le contraste qu’il met en lumière entre deux mondes : d’un côté le Vietnam de l’après-guerre, dont on perçoit les difficultés à travers les lettres que la famille restée au pays envoie (on y devine la famine de 1980, la débrouille du quotidien sous embargo, la persécution des « anciens riches »), et de l’autre le Québec des années 1980 où grandit la narratrice, pays de paix et de froid, où elle peut devenir ce qu’elle veut mais où elle reste marquée par son histoire. J’ai appris incidemment en lisant Ru que le Canada a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés vietnamiens à cette époque, et j’ai pu mieux comprendre le parcours de ces familles déracinées. Mais au-delà de ces informations, c’est le cœur du lecteur qui est sollicité à chaque page. Par exemple, il y a un passage où la narratrice parle de son enfant handicapé qu’elle élève au Canada, en le comparant à un petit cousin resté au Vietnam, né avec des malformations à cause de l’agent orange. Elle réalise la chance qu’elle a eue, et en même temps la culpabilité de ceux qui sont partis vers une vie meilleure. Ce genre de réflexion intime, livrée avec pudeur, m’a profondément ému. Ru est un voyage littéraire tout en douceur et en nostalgie, qui m’a fait traverser le temps et l’espace du Vietnam au Canada, et qui m’a rappelé que derrière chaque exil se cache une berceuse – parfois douloureuse, parfois pleine d’espoir – que l’on chante pour se donner du courage.
Les montagnes chantent – Nguyễn Phan Quế Mai
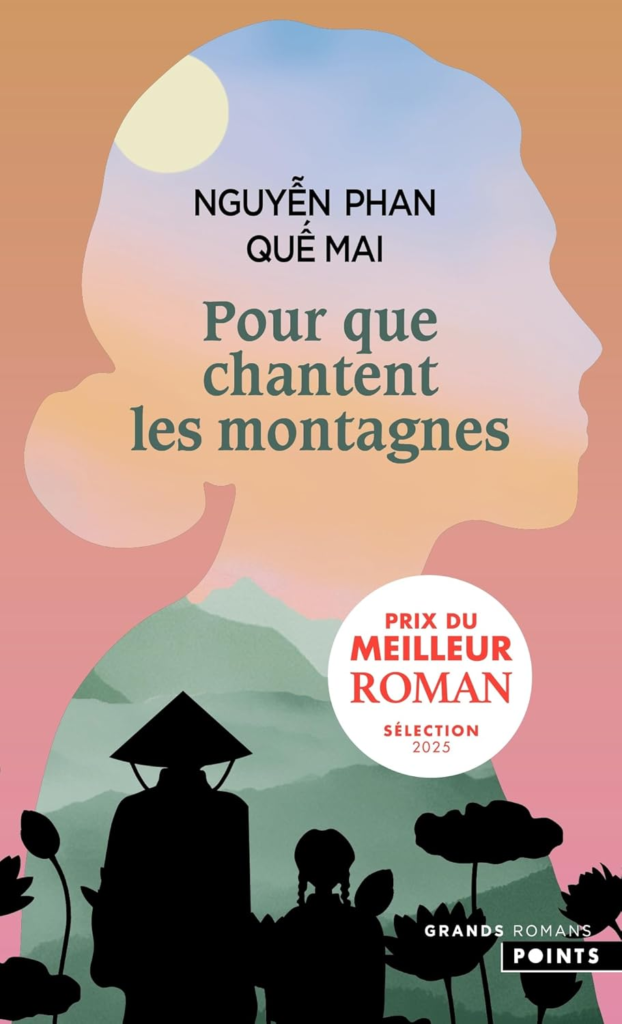
Dernière escale de notre voyage littéraire au Vietnam, et non des moindres : Pour que chantent Les montagnes de Nguyễn Phan Quế Mai. Ce roman, paru en 2020 (d’abord en anglais sous le titre The Mountains Sing), est une véritable saga familiale vietnamienne qui traverse le XXe siècle comme on traverse une chaîne de montagnes, avec ses sommets de joie et ses vallées de larmes. L’auteure, née au Vietnam, raconte l’histoire de la famille Trần sur plusieurs générations. Au centre, deux voix alternent : celle de Diệu Lan, la grand-mère, née dans les années 1920 dans une famille de paysans prospères du Nord, et celle de Hương, sa petite-fille adolescente, qui grandit dans les années 1970 à Hanoï. Le roman s’ouvre sur une scène inoubliable : pendant le grand bombardement américain sur Hanoï à Noël 1972, la grand-mère entraîne Hương en lieu sûr tandis qu’autour d’elles les bombes éclairent le ciel nocturne. À partir de là, le récit tisse le destin des Trần en aller-retour entre le passé de Diệu Lan et le présent de Hương. À travers les yeux de la grand-mère, on revit des épisodes cruciaux de l’histoire du Vietnam. Jeune femme, Diệu Lan a tout perdu lors de la grande famine de 1945 puis pendant la réforme agraire menée par le nouveau régime communiste au Nord au milieu des années 1950 – des chapitres du roman d’une force incroyable, où l’on voit les villageois se dresser les uns contre les autres, aveuglés par l’idéologie, ce qui n’est pas sans rappeler certaines pages des Paradis aveugles. Plus tard, la famille est de nouveau déchirée par la guerre : sur les six enfants de Diệu Lan, certains partent combattre dans les rangs nord-vietnamiens, tandis qu’un autre s’engage du côté sud-vietnamien, illustrant tragiquement la guerre fratricide qui a opposé deux camps d’un même peuple. Avec Hương, l’adolescente des années 70, on découvre le Hanoï d’après-guerre, un univers de pénurie où tout manque sauf la solidarité et l’amour familial. Hương attend le retour de ses parents partis sur le front sud, et en attendant, elle écoute les récits de sa grand-mère qui lui transmet la mémoire familiale, le bon comme le pire, pour qu’elle comprenne d’où elle vient.
Lire Pour que chantent les montagnes, c’est embrasser du regard tout un pan de la culture et de l’histoire vietnamiennes à travers une histoire intime. L’auteure parvient à nous faire passer des rizières paisibles du Haut Tonkin aux rues animées de Hanoï, des années de la colonisation française aux bouleversements du XXIe siècle, sans jamais nous perdre en route. Au contraire, on s’attache profondément à Diệu Lan, à Hương et aux autres membres de la famille, et on vit avec eux chaque épreuve comme si on y était. J’ai été particulièrement touché par la figure de la grand-mère, véritable héroïne du roman, qui malgré les tragédies (et Dieu sait que le Vietnam du XXe siècle en a connues : colonisation, famine, guerres, exodes…) conserve une dignité et un courage admirables. Une des plus belles images du livre, pour moi, c’est celle des montagnes qui “chantent”. Le titre vient d’un proverbe vietnamien que la grand-mère enseigne à Hương : il faut du temps et de la persévérance pour que les montagnes se mettent à chanter, métaphore de l’espoir qui renaît après les tempêtes. Et en effet, malgré les larmes versées au fil des pages, il y a dans ce roman une lumière, une chaleur humaine constante. J’ai refermé Les montagnes chantent le sourire aux lèvres et les yeux un peu embués, avec le sentiment d’avoir moi aussi fait partie de la famille Trần. Au-delà des faits historiques (j’ai appris par exemple l’existence de cette famine de 1945 qui tua près d’un million de Vietnamiens, un drame souvent éclipsé par la suite par la guerre d’Indochine, ou encore les dures réalités de la vie à Hanoï sous embargo dans les années 80), c’est la saga humaine qui m’a emporté. Ce roman est une magnifique conclusion pour notre voyage littéraire, car il résonne comme un chant d’amour pour le Vietnam, capable de traverser les pires épreuves et de se relever, encore et toujours.
Voilà, notre voyage au Vietnam par la magie des livres s’achève ici, après sept escales riches en émotions et en découvertes. De la Saigon coloniale de Marguerite Duras aux montagnes chantantes de Nguyễn Phan Quế Mai, nous avons parcouru près d’un siècle d’histoire vietnamienne, croisé des destins de fiction qui éclairent la réalité d’un peuple incroyablement résilient. J’espère que ces quelques pages vous auront donné envie de découvrir à votre tour ces romans et, à travers eux, un Vietnam multiple : tour à tour sensuel et tourmenté, traditionnel et bouleversé par l’Histoire, ancré dans ses rizières et dispersé aux quatre coins du monde par l’exil.
La littérature nous offre ce cadeau précieux : abolir les distances et les époques pour nous faire vivre, le temps d’une lecture, une aventure humaine et sensorielle profonde.



0 commentaires